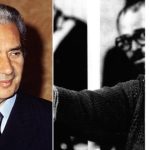Cette question touche le cœur même du paradoxe de la justice dans toute société capitaliste !
La justice, dans son essence, devrait être la colonne vertébrale morale d’une société. Mais en Haïti, elle n’est trop souvent qu’une façade institutionnelle, un outil manié par les puissants pour donner forme légale à l’injustice sociale.
On nous répète que la justice est égale pour tous alors même que certains détiennent la capacité d’influencer, d’acheter ou de détourner la loi à leur avantage. C’est là le premier mensonge de notre République : confondre justice et privilège légalisé.
Si le but de la justice est d’être juste, mais que signifie être juste dans un monde où le pouvoir n’est jamais réparti de façon égale ?
Dans un pays où la loi est une fiction écrite par ceux qui ont les moyens de la contourner, la justice cesse d’être une lumière ; elle devient une architecture du mensonge. Elle est, par définition, être aveugle à la richesse, au statut, à l’influence — un instrument de pouvoir.
Autrement dit : ceux qui ont le pouvoir de plier la loi finissent par fabriquer leur propre version du juste.
La justice, quand elle dépend du pouvoir, cesse d’être juste. Elle devient un mécanisme de régulation sociale — un outil pour maintenir un certain ordre, pas pour garantir une véritable égalité morale ou juridique.
Dans un État véritablement souverain, la justice n’existe pas pour humilier le faible, mais pour rétablir l’équilibre. Elle ne cherche pas à imposer une égalité abstraite, mais à empêcher que la force ne devienne la vérité. Car ce n’est pas l’égalité qui fonde une société juste — c’est l’équilibre des pouvoirs, des droits et des devoirs.

Une justice qui protège l’État contre le peuple n’est plus la justice : c’est la tyrannie en robe noire.
Alors oui, le véritable but n’est pas l’égalité absolue, mais l’équilibre. Nous devons comprendre que l’inégalité est une donnée du réel : les hommes ne naissent pas avec les mêmes moyens, ni les mêmes opportunités. Parce que l’égalité pure est souvent impossible dans un monde inégal par nature (par le savoir, la force, la richesse, les réseaux). Mais l’équilibre, lui, consiste à faire en sorte que le pouvoir ne détruise pas la dignité des plus faibles, et que la loi reste un espace de protection, pas d’humiliation.
Autrement dit : le rôle de la justice est précisément de corriger cette asymétrie, non de l’amplifier. Là où la loi devient un privilège réservé à ceux qui peuvent la manipuler, la nation entre en phase terminale de corruption morale.
Et Haïti, aujourd’hui, vit cette agonie à ciel ouvert. Nos tribunaux jugent sans preuves. Nos prisons regorgent d’innocents pendant que les vrais coupables siègent dans les salons du pouvoir. Nos magistrats se vendent pour survivre, nos avocats marchandent la vérité, nos ministres signent des décrets pour plaire à l’étranger — pendant que le peuple, lui, paie la facture de chaque trahison. Voilà pourquoi notre justice ne peut pas être respectée : elle a cessé d’être juste.
Dans les livres, la justice est aveugle. Dans la réalité, elle porte les lunettes du pouvoir. Car dans nos sociétés, celui qui possède le capital, les réseaux ou le prestige, possède aussi la capacité de façonner la perception du juste. Et quand la justice devient un théâtre où les puissants jouent au vertueux pendant que les pauvres paient les frais du décor, elle ne protège plus la société — elle la trahit.
Mais le peuple, lui, comprend. Il sait que l’ordre n’a de sens que s’il sert la dignité humaine. Il sait qu’un État qui tue pour imposer la paix ne fonde pas une nation : il fonde la peur. Et un pays gouverné par la peur n’a plus d’avenir.
C’est pourquoi le vrai but de la justice ne peut pas être l’égalité, mais l’équilibre. L’équilibre entre la force et la dignité. Entre l’ordre et la liberté. Entre la sanction et la réparation.
Je dis ceci, sans détour : La justice haïtienne doit être refondée, non réformée. Il faut la déraciner de la servitude coloniale et de la dépendance économique où elle s’est fossilisée. Nous devons inventer une justice de libération, enracinée dans la réalité sociale du pays — une justice qui répare avant de punir, qui réintègre avant de condamner, qui éduque avant d’éliminer.
Parce que l’égalité pure est une illusion : les hommes ne naissent pas égaux en pouvoir, en savoir, en influence. Mais le rôle de la justice est d’empêcher que cette inégalité naturelle ne devienne une tyrannie sociale. Elle doit être ce contrepoids moral qui empêche la puissance de tout écraser — non pas pour rendre tout le monde identique, mais pour empêcher que quelqu’un devienne Dieu.
Car la justice ne doit pas être un instrument d’humiliation, mais un outil de cohérence nationale. Elle doit rétablir la symétrie morale entre l’État et le citoyen. Autrement, ce que nous appelons “justice” ne sera jamais qu’une continuité du crime — le crime légal du pouvoir sur les faibles.
En Haïti, cette question n’est pas abstraite : elle est existentielle. Car nous vivons dans un pays où la justice n’a pas de racine populaire, où les lois sont souvent importées, où les institutions servent plus à protéger les privilèges qu’à équilibrer les injustices.
 La justice haïtienne ne garantit pas la vérité : elle garantit la continuité du désordre légal. Et dans ce désordre, le pauvre devient coupable par défaut, pendant que le riche devient intouchable par définition.
La justice haïtienne ne garantit pas la vérité : elle garantit la continuité du désordre légal. Et dans ce désordre, le pauvre devient coupable par défaut, pendant que le riche devient intouchable par définition.
Alors oui — le but de la justice devrait être l’équilibre. Pas pour maintenir l’ordre des élites, mais pour restaurer la cohérence morale de la nation. Pour que l’État cesse d’être un bourreau qui écrase ses enfants, et redevienne une main ferme, mais juste, qui redresse sans détruire.
Tant que la justice sera une arme au service du pouvoir, la société haïtienne restera un champ de bataille où la loi n’aura jamais d’âme.
Haïti ne peut pas renaître tant qu’elle ne brise pas ce cercle vicieux. Nous ne voulons pas d’une justice importée, commanditée ou mimée : nous voulons une justice vraiment souveraine, libérée des mains de ceux qui confondent l’ordre avec la domination. Car sans équilibre, il n’y a pas de justice. Et sans justice, il n’y a pas de nation.
En résumé :
La justice idéale cherche la vérité.
La justice humaine cherche la stabilité.
Et la justice politique cherche l’équilibre du rapport de force.
La question qu’il faut donc poser à un pays comme Haïti n’est pas seulement : « La justice est-elle égale pour tous ? »
Mais plutôt : « À qui la justice sert-elle ? Et jusqu’où protège-t-elle la société contre les abus du pouvoir ? ».