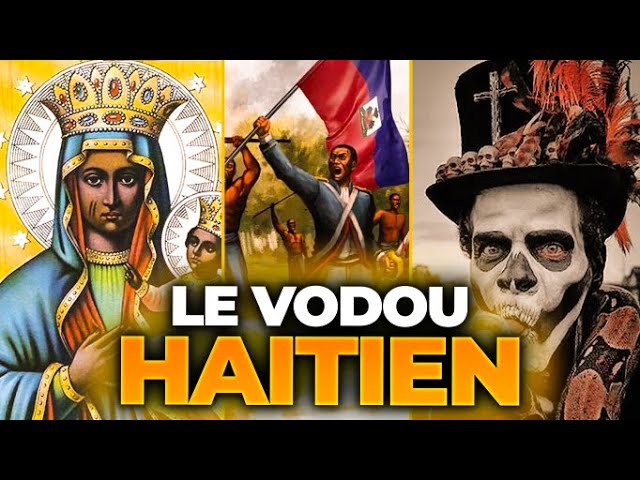Cette mauvaise réputation n’est pas une coïncidence, mais un projet pervers, imprégné de racisme, qui perdure encore aujourd’hui.
Quand vous pensez au vaudou, quelle est la première image qui vous vient à l’esprit ? Imaginez des poupées avec des épingles, des zombies téléguidés par des sorciers, ou tout autre scénario sinistre. C’est le signe que vous êtes une personne ordinaire, absorbée par la culture occidentale. Après tout, rien qu’en considérant les films hollywoodiens, plus de 70 productions sont répertoriées dans la section « Films sur le vaudou » de Wikipédia, et la quasi-totalité d’entre elles exploitent des stéréotypes négatifs.
Et ce ne sont pas seulement les films, mais aussi les chansons, les dessins animés, les reportages, les articles d’opinion et les blagues, apparemment innocents, qui véhiculent et entretiennent des préjugés qui contribuent à réduire la religion haïtienne à quelque chose de fondamentalement maléfique, loin de la réalité. « On dit que le vaudou est le diable, qu’il apporte la mort, mais qu’il est la vie. Pratiquer le vaudou, c’est protéger la vie, lui permettre de suivre son cours. Pratiquer le vaudou, c’est respecter l’environnement, les arbres et coexister avec la nature », résume le sociologue haïtien Moïse Dayiti.
Le rapport Brasil de Fato s’est rendu en Haïti, où il a constaté que cette pratique, d’origine africaine et introduite en Amérique par les esclaves, tout comme le Candomblé et l’Umbanda ici, et la Santería à Cuba, sont des pratiques animistes et dynamiques qui prônent le respect de l’environnement et l’harmonie avec la nature.
Et avec beaucoup de musique. Voici un exemple de la ressemblance entre les chants des services vaudous et ceux de nos traditions d’Umbanda et de Candomblé.
À l’instar des religions afro-brésiliennes, le vaudou est un produit de la diaspora africaine, une façon dont ces peuples asservis se sont adaptés à leur nouvel espace, apportant avec eux des esprits déjà vénérés dans leurs lieux d’origine. Il n’a pas d’autorité centrale comme un pape ; les prières sont généralement collectives, avec une abondante présence de tambours, de musique, de danses et d’entités incarnées lors des rituels. Il a également été rejeté par le christianisme. « Les religions nées à l’époque coloniale sont interprétées par ce pouvoir, par les Européens blancs, comme des religions déviantes, des façons erronées de se rapporter aux divinités. Elles sont interprétées à travers le prisme du racisme anti-noir », explique Rodrigo Bulamah, anthropologue et professeur à l’Université d’État de Rio de Janeiro (UERJ).
Sa collègue du Centre d’études religieuses de l’UERJ, Joana Bahia, soutient qu’« il est difficile de faire accepter les populations, les pensées et les religions non chrétiennes dans une société chrétienne ». Elle explique qu’au Brésil, les religions afro-brésiliennes ont trouvé des moyens de résister à ce racisme, principalement par l’art. « La musicalité brésilienne, apparue sous la Première République à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, repose à 90 % sur des paroles de chansons », explique Bahia.

Histoire
Si au Brésil, les cultes afro-brésiliens ont eu recours à l’art pour survivre, dans les Caraïbes, les Haïtiens ont eu recours au vaudou pour accéder à la liberté et devenir le premier pays américain à abolir par la force l’esclavage et le joug colonial français, en 1804. Et, aujourd’hui encore, à la fois pour punir et pour éviter qu’il ne devienne une source d’inspiration pour d’autres peuples opprimés, le pays paie le prix fort pour une telle audace.
Mais l’inspiration et le moteur de la Révolution haïtienne furent le vaudou. « Le 14 août 1791, lors de la cérémonie du Bwa Kayman, la prière Dutty Boukman fut récitée, au cours de laquelle les participants invitèrent un groupe d’entités vaudou – personnes, ancêtres et entités appelées loa [semblables aux orishas du candomblé] – à participer à la lutte pour l’indépendance », expliquait le sociologue haïtien Moïse Dayiti à Brasil de Fato.
Dayiti affirme que la relation entre politique et vaudou n’a jamais faibli et demeure l’un des piliers de l’identité du pays, malgré les combats et les dénigrements qu’elle a subis depuis la colonisation jusqu’à nos jours. « Les Français ont abattu nos arbres sacrés, prétendant que c’était l’œuvre du diable. Aujourd’hui, ils mentent beaucoup, prétendant que la violence est due au vaudou. Or, le vaudou a toujours été une source de résistance culturelle, politique et économique ; il imprègne toutes les sphères de la vie. »
« La religion vaudou contredit la logique individualiste imposée par l’Occident et le christianisme. Dans le vaudou, la communauté prime sur l’individu. Si les Haïtiens résistent aujourd’hui, c’est grâce au vaudou et à la langue créole », conclut-il.
L’anthropologue Rodrigo Bulamah, également auteur de *Ruines circulaires : une anthropologie de l’histoire du nord d’Haïti*, décrit le vaudou dans ce rapport comme un système de connaissances qui prend en compte les esprits et les ancêtres, influençant la vie quotidienne, la politique, la protection et la guérison. Il met l’accent sur la production communautaire et la solidarité, avec des esprits habitant la nature, et promeut la protection de l’environnement, contrairement à l’individualisme occidental. De plus, il coexiste harmonieusement avec les autres religions.
En ce sens, il est également très similaire au Brésil. Les gens changent très facilement de religion car ils interagissent avec différentes forces et figures de pouvoir, comme les prêtres, les curés, les mambôs et les pai de santos, explique-t-il.
À qui profitent tant de préjugés ?
Bulamah explique que l’occupation américaine (1915-1934) a tenté d’éradiquer le vaudou, « les Marines abattant les arbres, qui étaient les demeures des esprits », mais cette initiative a fini par renforcer davantage la croyance. « En abattant un arbre, vous attestez que l’esprit y réside. En condamnant un prêtre, vous attestez qu’il possède un pouvoir spirituel ; vous ne pouvez l’ignorer », dit-il. Bulamah explique que sous les gouvernements de Jean Bertrand Aristide (1991, 1994-1996 et 2001-2004), le vaudou a été réhabilité. « Guidé par la théologie de la libération, Aristide a reconnu le vaudou comme une religion populaire qui devait être respectée et intégrer la pluralité religieuse. »
L’anthropologue explique que « plus récemment, ce sont les Églises pentecôtistes qui ont commencé à persécuter le vaudou en Haïti. »
« De nombreux missionnaires étrangers ravivent le racisme anti-Noirs en construisant des écoles, en investissant dans les quartiers populaires et en prétendant que le vaudou est un mal. Ce vaudou a même provoqué le grand tremblement de terre de 2010 [qui a tué 300 000 Haïtiens]. »
Oui, aussi absurde que cela puisse paraître, un chroniqueur du journal américain The New York Times a relayé cette absurdité. En cette douloureuse année 2010, David Brooks écrivait que le vaudou avait contribué au retard d’Haïti en prêchant l’incertitude du destin et l’inutilité de toute planification. Par conséquent, selon sa logique, la responsabilité de tant de décès incombait au vaudou, qui a empêché les Haïtiens de se préparer adéquatement au tremblement de terre.
Bulamah réfute cet argument raciste en affirmant que « la relation avec les esprits était imprégnée de valeurs morales telles que la solidarité, la protection de la nature et l’hommage aux ancêtres qui ont lutté contre l’esclavage ». Cela impliquait toujours de planifier ce qui serait offert pour les festivités et aussi, occasionnellement, de se protéger d’une personne sur le point de migrer.
Même ici au Brésil, il semble y avoir une licence pour diffamer la religion haïtienne, même parmi les progressistes. En 2018, le chroniqueur de Folha de São Paulo, Clóvis Rossi (1943-2019), a publié un article intitulé « La corruption vaudou déshonore-t-elle Haïti ? » Dans ce livre, il étale ses clichés et ses préjugés en toute impunité. Il ne manquait que la mention des poupées à épingles et des zombies.
En fait, Rodrigo Bulamah affirme que, comme ce que nous voyons ici, il existe cette « pratique consistant à prendre une photo d’une personne et à la placer quelque part, comme s’il s’agissait d’un vêtement ».
Cela fait partie de l’univers magique que l’on retrouve dans diverses religions, en fait. La religion catholique en offre également de nombreux exemples. L’hostie, comme le corps de Jésus, est un processus de métamorphose du Christ en cet objet », conclut-il.
Mais au-delà de l’obscurantisme chrétien, que se cache-t-il derrière tant de publicité négative, cette campagne de diffamation de la religion haïtienne ? Le géographe Wisnel Joseph, animateur du podcast « Haïti est aussi ici », ainsi que de nombreux penseurs haïtiens, ont soutenu lors de l’entretien avec la BdF que cette image négative est le résultat d’un projet historique visant à isoler et à affaiblir la première république noire du monde. « Haïti n’est pas un pays pauvre, mais Haïti est un pays appauvri », a-t-il déclaré. Édité par : María Teresa Cruz
Brasil de Fato 22 septembre 2025